"Ce cœur changeant", le dernier ouvrage d’Agnès Desarthe aux Éditions de l’Olivier, a des allures de roman d’apprentissage, suivant le parcours de Rose, oie blanche débarquée à Paris au début du siècle dernier pour y subir les tours d’un destin facétieux. Il n’y a aucune volonté chez la romancière de l’ériger en victime ou en héroïne. Et c’est peut-être parce que la notion de combat en littérature, qu’il soit intime ou politique, semble étrangère à Agnès Desarthe. Et pourtant, en y réfléchissant bien…
Il y a un personnage fondamental dans le livre qui mêle l’intime et le politique, c’est le bébé.
C’est le personnage, sans doute, qui a motivé l’écriture de Ce cœur changeant. Très tôt, j’ai su qu’il allait y avoir un bébé dans le livre, parce que j’avais envie de travailler ce personnage peu présent dans la littérature. Au moment de l’écriture, j’avais moi-même un tout petit enfant. J’étais donc très proche de cette présence étonnante. Car un bébé est à la fois l’être le plus puissant et le plus impuissant qui soit, c’est fascinant. En tant qu’auteur, le physique des personnages m’intéresse beaucoup : les corps, la peau, les parfums… Et il y a beaucoup à dire sur les bébés avec leur odeur, le grain de leur peau, leur solidité et leur fragilité, leurs proportions étranges, leurs cris… Il y a déjà quelques années que j’avais fait ce constat : il n’y a pas de bébés dans les romans. Ce qui s’explique, si on considère que, pendant la plus grande partie de son histoire, la littérature a été un domaine masculin. Je ne dis pas que les bébés sont une affaire de femmes, mais ce que je constate, c’est que ça n’est pas une affaire d’hommes. Et c’est en cela, en plaçant le bébé au cœur du récit, en m’y intéressant, en m’y attardant, qu’il devient, sans doute, un sujet politique.
Politique aussi dans le sens où un bébé peut changer le cours d’une vie professionnelle?
Non. Pas pour moi, en tout cas. La seule chose qui a changé pour moi, c’est que pendant que mon bébé était tout petit, j’ai écrit des nouvelles. Un roman, ça n’aurait pas été possible. Donc si ça a changé quelque chose dans ma vie professionnelle, c’est juste dans l’exercice de mon métier. Je sais que ça n’est pas le cas pour tout le monde, mais ça n’était pas mon propos.
Il ne s’agissait donc pas d’un combat féministe…
S’il y a combat, c’est un combat d’écrivain, un combat esthétique et littéraire. L’irruption du bébé dans la vie des gens qui l’accompagnent, c’est un bouleversement terrible. Pour le couple, c’est un choc épouvantable. Assez peu s’en remettent, finalement… Alors que d’une certaine manière, le bébé est la finalité du couple. Et la première chose qu’un être fait en arrivant au monde, c’est souvent de faire exploser ce couple parental. D’ailleurs, dans la nature, la plupart des animaux se séparent après la procréation. En tant qu’écrivain, je trouve passionnants ces mouvements paradoxaux — d’union, de séparation, de bouleversement. Et parce que le couple est une entité aussi bien intime que sociale, on reste avec l’arrivée d’un bébé au cœur de cette problématique intime/politique.
Mais vous êtes une femme qui écrit sur les conséquences de l’apparition d’un bébé dans la vie d’une autre femme. Ça ressemble pourtant à un discours féministe.
J’ai éprouvé le besoin d’écrire un livre en costumes, de prendre une distance temporelle. Et de ne pas donner à ce personnage des parents hétérosexuels. Le bébé arrive dans la vie de Rose par accident, au moment où elle est en couple avec une femme. Ça fait un double pas de côté par rapport à la « norme », qui veut qu’un enfant vive avec deux géniteurs hétérosexuels. Alors on pourrait croire que mon sujet, c’est le mariage homosexuel ou l’homoparentalité, mais ça n’est pas de cela que je parle. En réalité, il y a une double motivation à ce choix. D’abord, comme en philosophie, l’expérience du cas-limite : puisque je veux montrer que l’irruption du bébé est quelque chose de toujours choquant, je décris un cas-limite. Deux femmes ont un bébé qu’elles n’ont pas choisi d’avoir. Et pourtant il est là, et il déclenche de la surprise, voire de l’effroi. Par ailleurs, si j’écris un livre avec un bébé qui se passe de nos jours, comme je suis une femme, je vais être cataloguée dans la « littérature de femme ». Ce qui n’est pas mélioratif, on le sait bien. Je sors de la littérature générale ; pour le dire crûment, je suis foutue en tant qu’écrivain. Donc que je suis obligée — et c’est une contrainte qui me plaît — de m’écarter de mon modèle, d’aller plus loin. Afin d’être plus libre.
Ce cœur changeant, c’est le parcours d’une jeune femme candide qui subit un destin capricieux mais finit par prendre, enfin, sa vie en main…
Ce roman emprunte des déguisements au roman d’apprentissage : on a une jeune personne qui ne connaît rien de la vie et qui vit des expériences. Dans le roman d’apprentissage, les expériences sont supposées la faire avancer, l’aider à s’élever dans la société. Mais Rose fait du surplace. Elle ne tire aucune leçon de ses échecs, elle ne bâtit aucun projet. C’est l’anti-Rastignac. Je m’en amuse. Je fais une farce avec le roman d’apprentissage. Je détourne cette phrase de Marguerite Duras qui dit en substance : « J’écris pour voir ce que j’écris quand j’écris ». Rose vit pour voir ce qu’elle vit quand elle le vit. Et pour ma part, c’est de la curiosité, de l’expérience au sens chimique. Je mets des éléments en présence et j’observe comment ils réagissent.
Mais Rose évolue, tout de même.
Disons qu’elle profite d’une évolution, mais il ne s’agit pas d’une évolution sociale. Elle évolue dans son rapport au langage. Quasi muette au début du récit, elle se met à parler puis à écrire. C’est sa manière d’accéder à une autonomie. Et elle y parvient avec l’irruption dans sa vie du bébé. Jusque-là, elle n’était que le jouet du sort. Mais elle se trouve dans une situation où, pour la première fois de sa vie, elle prend une décision. J’ai été surprise moi-même en écrivant cette série de scènes très morcelées autour de l’arrivée du bébé. Car d’un coup, Rose s’est mise à parler à la première personne. Ça m’est venu sous les doigts de manière très naturelle, alors que tout le récit était à la troisième personne. Et je ne me suis rendu compte de ce glissement qu’au moment de la relecture. Je l’ai maintenu, car il a un sens : l’affirmation de l’autonomie se marque grammaticalement. Pouvoir dire « je » pour une femme, finalement, c’est un enjeu aussi intime que politique.
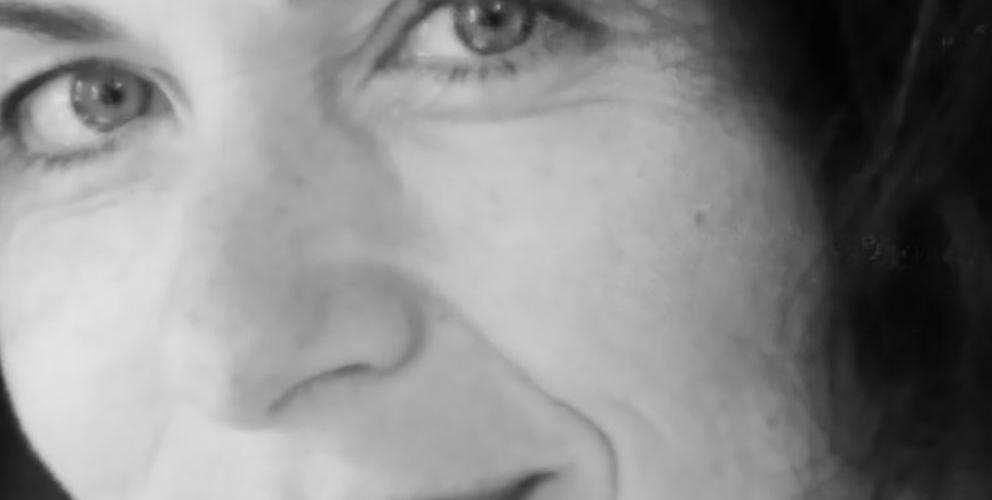
Laure Albernhe
